
Clichés Confinés
La première quinzaine de confinement COVID19 vient de s’achever, et une seconde est sur le point de commencer. J’écris ces mots sur le clavier en croisant les doigts pour qu’il n’y en ait pas trop encore, et c’est pas pratique. Postant déjà une photo quotidienne sur les réseaux sociaux illustrant cette période étrange, je ne voulais pas tenir ici de « Journal de Confinement ». Parce que d’autres font ça beaucoup mieux, et aussi parce que ce que je vis me semble tellement dérisoire et futile en comparaison du quotidien de celles et ceux directement impliqués dans la lutte contre ce virus et ses conséquences. Et puis je me suis dit que vu les circonstances, si je n’écrivais rien là-dessus ici, sur quoi donc pourrais-je bien écrire à l’avenir…
Avant même le début du confinement, un mauvais pressentiment nous avait fait annuler nos vacances à Saint-Martin. Le pas envie de contribuer sans le savoir à la propagation d’une pandémie accompagnée de la peur de ne pas pouvoir rentrer... Et en effet, vu le déroulé des dernières semaines, nous aurions été bien ennuyés d’être confinés là-bas avec nos vols retours annulés. Alors l’annonce du confinement, finalement, je l’ai plutôt bien vécue. Non seulement elle était nécessaire (et tardive pour les raisons qu’on connait) mais en plus, d’un point de vue nettement plus nombriliste, elle confirmait que nous avions fait le bon choix. On n’avait pas annulé pour rien. On se rattache parfois à des choses étranges.
Isolé à Paris dans mes 40 m² avec mes plantes vertes, plutôt qu’accompagné à Toulouse donc. Je ne me suis pas posé la question. Je ne voulais pas m’éloigner de mon père. C’est d’ailleurs complètement con, puisque je ne peux lui rendre visite. Et puis après, j’ai vu comment avaient été traités tous ces parisiens qui ont fui la capitale pour la province… Bref, puisque je suis là, j’y reste. Et j’essaye de faire avec. Ou plutôt sans…
Ma rue, un grand boulevard du 18e arrondissement, est progressivement devenue déserte. En bientôt 23 ans, je ne l’avais jamais vue ainsi, un silence qui réussit à être à la fois plaisant et angoissant.
Isolé ? Pas vraiment en fait. J’ai l’impression de n’avoir jamais été aussi connecté aux autres qu’actuellement. Les coups de téléphone et les échanges de sms se multiplient. Une impression de discuter davantage avec les amis et les proches de la famille. On échange sur notre ressenti du moment, sur nos espoirs et nos doutes. On plaisante en disant des horreurs qu’on n’oserait pas écrire sur nos réseaux sociaux.
Untel espère que nous retiendrons la leçon et que la société prendra après la crise une orientation plus humaine et responsable. Suis-je pessimiste ? Cette idée me laisse complètement dubitatif. Quand je vois que trois jours après les belles paroles du président sur la conception du monde qui devra changer, ses ministres étaient tous au diapason pour sauver l’Économie d’un naufrage, avec un plan de sauvegarde de ce même système qui nous conduit là aujourd’hui. Je n’y crois pas une seconde.
Et pourtant, il me reste une petite voix qui chuchote tout au fond « et si… ».
Si seulement chaque prise de parole officielle ne contribuait pas à la faire taire…
L’isolement est aussi rompu par la résurrection des blogs. Certains reprennent la plume, ouvrent de nouveaux cahiers. Retrouver ce plaisir de vous lire.
Avant même le début du confinement, un mauvais pressentiment nous avait fait annuler nos vacances à Saint-Martin. Le pas envie de contribuer sans le savoir à la propagation d’une pandémie accompagnée de la peur de ne pas pouvoir rentrer... Et en effet, vu le déroulé des dernières semaines, nous aurions été bien ennuyés d’être confinés là-bas avec nos vols retours annulés. Alors l’annonce du confinement, finalement, je l’ai plutôt bien vécue. Non seulement elle était nécessaire (et tardive pour les raisons qu’on connait) mais en plus, d’un point de vue nettement plus nombriliste, elle confirmait que nous avions fait le bon choix. On n’avait pas annulé pour rien. On se rattache parfois à des choses étranges.
Isolé à Paris dans mes 40 m² avec mes plantes vertes, plutôt qu’accompagné à Toulouse donc. Je ne me suis pas posé la question. Je ne voulais pas m’éloigner de mon père. C’est d’ailleurs complètement con, puisque je ne peux lui rendre visite. Et puis après, j’ai vu comment avaient été traités tous ces parisiens qui ont fui la capitale pour la province… Bref, puisque je suis là, j’y reste. Et j’essaye de faire avec. Ou plutôt sans…
Ma rue, un grand boulevard du 18e arrondissement, est progressivement devenue déserte. En bientôt 23 ans, je ne l’avais jamais vue ainsi, un silence qui réussit à être à la fois plaisant et angoissant.
Isolé ? Pas vraiment en fait. J’ai l’impression de n’avoir jamais été aussi connecté aux autres qu’actuellement. Les coups de téléphone et les échanges de sms se multiplient. Une impression de discuter davantage avec les amis et les proches de la famille. On échange sur notre ressenti du moment, sur nos espoirs et nos doutes. On plaisante en disant des horreurs qu’on n’oserait pas écrire sur nos réseaux sociaux.
Untel espère que nous retiendrons la leçon et que la société prendra après la crise une orientation plus humaine et responsable. Suis-je pessimiste ? Cette idée me laisse complètement dubitatif. Quand je vois que trois jours après les belles paroles du président sur la conception du monde qui devra changer, ses ministres étaient tous au diapason pour sauver l’Économie d’un naufrage, avec un plan de sauvegarde de ce même système qui nous conduit là aujourd’hui. Je n’y crois pas une seconde.
Et pourtant, il me reste une petite voix qui chuchote tout au fond « et si… ».
Si seulement chaque prise de parole officielle ne contribuait pas à la faire taire…
L’isolement est aussi rompu par la résurrection des blogs. Certains reprennent la plume, ouvrent de nouveaux cahiers. Retrouver ce plaisir de vous lire.
On a parfois une opinion de soi, et il suffit d’un événement pour qu’on prenne conscience de notre inutilité. Dans la situation actuelle, je ne sers à rien et suis prié de rester enfermé chez moi. Ça remet des pendules à l’heure. J’aimerais être dans la tête de ceux qui râlaient contre tous les manifestants de ces derniers mois, les personnels de santé, les pompiers, et autres, jusqu’aux petites gens qui marchaient pour quelques sous de plus. Aujourd’hui ce sont sur ceux-là que nous comptons pour survivre en attendant qu’on nous sorte de ce marasme. J’aimerais être dans leur tête, pas longtemps, juste pour savoir s’ils ont pris conscience de leur bêtise, s’ils ont compris qu’il y a un minimum vital sur lequel on ne peut transiger.
Aujourd'hui, j'ai employé le mot EXTRUDER. Tout est encore possible.
Des jours étranges. Certains de mes projets immédiats ont été purement et simplement annulés. J’ai donc du temps pour me consacrer à d’autres mis en suspens ou de plus longue haleine. J’évite de penser aux finances, il sera bien temps de vendre un rein le moment venu. Prendre le temps de faire les choses. Je redécouvre le plaisir de ne pas œuvrer dans l’urgence, mais de s’accorder le luxe de peaufiner. De faire comme on aimerait que ce soit fait et non parce qu’on a un timing à respecter.
Des connaissances ne sont pas du tout dans ce mode cotonneux, le télétravail n’était pas leur quotidien et ils doivent s’adapter à faire rentrer des ronds d’habitudes dans des carrés de contraintes. Je les vois s’en sortir avec bonheur. Se dire encore une fois que, dans mon relatif malheur, je suis un privilégié.
Quinze jours que je ne sors que pour m’aérer un quart d’heure matin et après-midi dans le jardin privé à l’arrière de l’immeuble. Il est réservé aux copropriétaires (une longue histoire de refus de la copro de financer entretien et assurance) et ils ont tous déserté Paris. Ma tentative d’en donner l’accès aux locataires s’est soldée par un échec cuisant, les règles élémentaires de sécurité sanitaire n’ayant pas été respectées. Marche arrière toute. Maintenant, seul dans cet espace vert encadré d’immeubles, j’ai un peu l’air d’un nain de jardin. En remontant, se laver les mains, de façon obsessionnelle, au cas où par mégarde j’aurais effleuré une rambarde de l’escalier. Je n’ose plus prendre l’ascenseur : ouvrir la porte, appuyer sur des boutons, retenir sa respiration jusqu'au 7ème, trop compliqué. Je me mens en me disant que ce choix n’est pas motivé par la peur mais par le souhait de faire un peu d’exercice. Sept étages deux fois par jour, tu parles d’une activité sportive !
Finalement, jusqu’à aujourd’hui, je n’ai quitté l’immeuble qu’une seule fois pour aller au Franprix au numéro de rue voisin. J’imagine que moins on sort, plus on psychote. Qui a touché ces poivrons que je vais acheter ? Les cartons des paquets de yaourts, c’est safe ? Dois-je tout laver en rentrant ? Mais pourquoi il me colle ce con ? J’espère que le lecteur CB n’est pas en panne, hors de question que je paye en espèce ? Je pensais avoir fait des courses pour la semaine, sans pour autant dévaliser les rayons, je tiendrai facilement quelques jours de plus. Tant pis pour les céréales. Pas envie d’y retourner de suite. La caissière est suffisamment exposée comme ça, si je peux lui épargner la visite d’un client supplémentaire, paranoïaque de surcroit, elle qui est exposée au quotidien. On a échangé quelques mots, comme on l’a toujours fait. Elle n’aime pas la vitre de plexiglas qui la protège devant sa caisse, une impression d’être en cage, mais elle en comprend la nécessité. Et là, le respect que tu avais déjà pour les personnes réquisitionnées pour que nous puissions survivre vient de doubler.
Encore un ami qui me texte pour m’informer qu’il a côtoyé une personne qui a été testée positive au virus. Je n’aime pas ça. Parce que je ressens leur crainte, cette épée de Damoclès. Mais surtout parce que systématiquement je me dis qu’après ce décompte des contaminés autour de nous viendra un autre décompte, autrement plus sinistre.
Je préfère ne pas savoir. Pas tout de suite.
D’ailleurs depuis le début du confinement, j’évite soigneusement tout comptage officiel.
Peut-être une façon de me préserver, de garder le moral.
Quand j’écris ces lignes, il est bientôt vingt heures. Bientôt l’heure où les gens vont sortir applaudir à leur fenêtre pour soutenir les professionnels de la santé et ceux qui prennent des risques pour nous. Je partage les arguments de ceux qui le font, tout comme les objections de ceux qui les critiquent. Pas la peine d’en faire la liste. Alors, certains soirs je me joins à eux et d’autres pas. Ça aussi, c’est complètement con, je sais. Pas envie de trancher, pas envie de polémiquer là-dessus. Parfois, comme ce soir, certains scandent « Du fric pour les services publics » ou « Plus jamais ça ». J’aime bien.
J’essaye de conserver mes horaires. De coucher, de lever.
Seule entorse aux habitudes : j’ai délaissé le rasoir. Je constate avec effroi que ma barbe est devenue beaucoup plus sel que poivre. Pas certain néanmoins qu’elle tienne jusqu’à la fin du confinement. Déjà je me brosse les dents dos au miroir. Et quand je me croise dans celui des placards de la chambre, je me demande quel est cet inconnu qui se lève de mon lit. Elle me démange, me gratte. La flemme d’y remédier doublée d’un défi stupide que je me suis lancé : jusqu’à quand vais-je tenir.
Macron et ses sbires tournent en boucle sur la thématique de la guerre. Une métaphore filée jusqu’à l’écœurement. Jusqu’à quand vais-je tenir ? Mon père avec qui je papote presque quotidiennement au téléphone ou par sms a eu cette pensée : « Si c’est la guerre, Macron et ses ministres sont les généraux qui n’ont pas payé pour les armes et hurlent aux troufions de sortir des tranchées alors qu’eux restent bien planqués à l’abri ». Son sens habituel de la formule, preuve qu’il va bien.
Et quand je les vois tous profiter de l’occasion pour ratiboiser des acquis sociaux sous prétexte de préserver l’économie plutôt que de concentrer leurs efforts à assurer la survie des personnes exposées, je me dis que les plaintes déposées par certains corps de métiers pourraient frôler la requalification en « crime de guerre ».
J’exagère, comme d’habitude.
On me dira que l’heure n’est pas à la condamnation de nos dirigeants. Peut-être, oui.
Je trouve tout de même ma pique moins indécente que le commentaire de cette éditorialiste qui affirme qu’avec le décès du premier homme politique français hier, l’épidémie « signe un tournant ». Un peu comme si toutes les autres morts, en France comme à l’étranger, étaient quantité négligeable.
Quand ici on sucre des acquis sociaux pour raviver un phœnix qui n’a pas encore de cendres, le Portugal régularise les immigrés pour les protéger et l’Espagne interdit les licenciements pendant la pandémie. Pendant ce temps, encore ici, la police, sécurisante dans les beaux quartiers, fait du zèle dans ceux populaires. Toujours les mêmes qui trinquent. Ce pays ne changera pas. Je redoute juste que nous nous y habituions.
Être confiné chez soi, c’est aussi se garder du temps pour maintenir une activité culturelle. Je me suis fait une liste de musées proposant des visites virtuelles, celle de Pompéi au Grand Palais mérite vraiment le détour. La vidéo de l’audioguide m’a vraiment changé les idées, ailleurs pour quelques minutes…
Je réécoute de vieux CD que je n’ai pas pris le temps de numériser jadis, je dresse des listes de films que j’ai envie de voir ou revoir. Et pour une fois que je suis plus de six jours tout seul, j’en profite pour me projeter une énième fois l’intégrale de la Saga d’Alien. D’ailleurs le cinquième volet m’attend, j’abrège ce papier même si j’ai envie de consigner ici encore deux trois choses. J’étais parti pour griffonner quelques lignes et j’ai encore gratté trois pages. Certains défauts ne changeront jamais…
Je pars en vous laissant autre chose à lire, si vous avez le temps.
J’ai découvert Annie Ernaux au lycée où la prof de français nous avait donné à étudier La Place, un de ses romans qui m’avait profondément marqué, un bouquin sur la vie simple de son défunt père, écrit avec une précision chirurgicale, factuelle dans un style particulièrement dépouillé. J’ai également apprécié par la suite d’autres de ses romans, et si ce confinement s’éternise, il est probable que j’en profite pour en lire de nouveaux. Mais, je me disperse encore !
Pour l’émission de Trapenard sur France Inter, Annie Ernaux écrit une lettre ouverte à Macron, à la fois naïve, percutante, touchante et intelligente. C’est toujours rassurant de ne pas être déçu par des gens qu’on estime. Ce n’est pas toujours le cas.
J’espère que le président lira cette lettre. Et surtout qu’il la comprendra…
D’ici la prochaine fois, prenez soin de vous.
Des jours étranges. Certains de mes projets immédiats ont été purement et simplement annulés. J’ai donc du temps pour me consacrer à d’autres mis en suspens ou de plus longue haleine. J’évite de penser aux finances, il sera bien temps de vendre un rein le moment venu. Prendre le temps de faire les choses. Je redécouvre le plaisir de ne pas œuvrer dans l’urgence, mais de s’accorder le luxe de peaufiner. De faire comme on aimerait que ce soit fait et non parce qu’on a un timing à respecter.
Des connaissances ne sont pas du tout dans ce mode cotonneux, le télétravail n’était pas leur quotidien et ils doivent s’adapter à faire rentrer des ronds d’habitudes dans des carrés de contraintes. Je les vois s’en sortir avec bonheur. Se dire encore une fois que, dans mon relatif malheur, je suis un privilégié.
Quinze jours que je ne sors que pour m’aérer un quart d’heure matin et après-midi dans le jardin privé à l’arrière de l’immeuble. Il est réservé aux copropriétaires (une longue histoire de refus de la copro de financer entretien et assurance) et ils ont tous déserté Paris. Ma tentative d’en donner l’accès aux locataires s’est soldée par un échec cuisant, les règles élémentaires de sécurité sanitaire n’ayant pas été respectées. Marche arrière toute. Maintenant, seul dans cet espace vert encadré d’immeubles, j’ai un peu l’air d’un nain de jardin. En remontant, se laver les mains, de façon obsessionnelle, au cas où par mégarde j’aurais effleuré une rambarde de l’escalier. Je n’ose plus prendre l’ascenseur : ouvrir la porte, appuyer sur des boutons, retenir sa respiration jusqu'au 7ème, trop compliqué. Je me mens en me disant que ce choix n’est pas motivé par la peur mais par le souhait de faire un peu d’exercice. Sept étages deux fois par jour, tu parles d’une activité sportive !
Finalement, jusqu’à aujourd’hui, je n’ai quitté l’immeuble qu’une seule fois pour aller au Franprix au numéro de rue voisin. J’imagine que moins on sort, plus on psychote. Qui a touché ces poivrons que je vais acheter ? Les cartons des paquets de yaourts, c’est safe ? Dois-je tout laver en rentrant ? Mais pourquoi il me colle ce con ? J’espère que le lecteur CB n’est pas en panne, hors de question que je paye en espèce ? Je pensais avoir fait des courses pour la semaine, sans pour autant dévaliser les rayons, je tiendrai facilement quelques jours de plus. Tant pis pour les céréales. Pas envie d’y retourner de suite. La caissière est suffisamment exposée comme ça, si je peux lui épargner la visite d’un client supplémentaire, paranoïaque de surcroit, elle qui est exposée au quotidien. On a échangé quelques mots, comme on l’a toujours fait. Elle n’aime pas la vitre de plexiglas qui la protège devant sa caisse, une impression d’être en cage, mais elle en comprend la nécessité. Et là, le respect que tu avais déjà pour les personnes réquisitionnées pour que nous puissions survivre vient de doubler.
Encore un ami qui me texte pour m’informer qu’il a côtoyé une personne qui a été testée positive au virus. Je n’aime pas ça. Parce que je ressens leur crainte, cette épée de Damoclès. Mais surtout parce que systématiquement je me dis qu’après ce décompte des contaminés autour de nous viendra un autre décompte, autrement plus sinistre.
Je préfère ne pas savoir. Pas tout de suite.
D’ailleurs depuis le début du confinement, j’évite soigneusement tout comptage officiel.
Peut-être une façon de me préserver, de garder le moral.
Quand j’écris ces lignes, il est bientôt vingt heures. Bientôt l’heure où les gens vont sortir applaudir à leur fenêtre pour soutenir les professionnels de la santé et ceux qui prennent des risques pour nous. Je partage les arguments de ceux qui le font, tout comme les objections de ceux qui les critiquent. Pas la peine d’en faire la liste. Alors, certains soirs je me joins à eux et d’autres pas. Ça aussi, c’est complètement con, je sais. Pas envie de trancher, pas envie de polémiquer là-dessus. Parfois, comme ce soir, certains scandent « Du fric pour les services publics » ou « Plus jamais ça ». J’aime bien.
J’essaye de conserver mes horaires. De coucher, de lever.
Seule entorse aux habitudes : j’ai délaissé le rasoir. Je constate avec effroi que ma barbe est devenue beaucoup plus sel que poivre. Pas certain néanmoins qu’elle tienne jusqu’à la fin du confinement. Déjà je me brosse les dents dos au miroir. Et quand je me croise dans celui des placards de la chambre, je me demande quel est cet inconnu qui se lève de mon lit. Elle me démange, me gratte. La flemme d’y remédier doublée d’un défi stupide que je me suis lancé : jusqu’à quand vais-je tenir.
Et quand je les vois tous profiter de l’occasion pour ratiboiser des acquis sociaux sous prétexte de préserver l’économie plutôt que de concentrer leurs efforts à assurer la survie des personnes exposées, je me dis que les plaintes déposées par certains corps de métiers pourraient frôler la requalification en « crime de guerre ».
J’exagère, comme d’habitude.
On me dira que l’heure n’est pas à la condamnation de nos dirigeants. Peut-être, oui.
Je trouve tout de même ma pique moins indécente que le commentaire de cette éditorialiste qui affirme qu’avec le décès du premier homme politique français hier, l’épidémie « signe un tournant ». Un peu comme si toutes les autres morts, en France comme à l’étranger, étaient quantité négligeable.
Quand ici on sucre des acquis sociaux pour raviver un phœnix qui n’a pas encore de cendres, le Portugal régularise les immigrés pour les protéger et l’Espagne interdit les licenciements pendant la pandémie. Pendant ce temps, encore ici, la police, sécurisante dans les beaux quartiers, fait du zèle dans ceux populaires. Toujours les mêmes qui trinquent. Ce pays ne changera pas. Je redoute juste que nous nous y habituions.
Être confiné chez soi, c’est aussi se garder du temps pour maintenir une activité culturelle. Je me suis fait une liste de musées proposant des visites virtuelles, celle de Pompéi au Grand Palais mérite vraiment le détour. La vidéo de l’audioguide m’a vraiment changé les idées, ailleurs pour quelques minutes…
Je réécoute de vieux CD que je n’ai pas pris le temps de numériser jadis, je dresse des listes de films que j’ai envie de voir ou revoir. Et pour une fois que je suis plus de six jours tout seul, j’en profite pour me projeter une énième fois l’intégrale de la Saga d’Alien. D’ailleurs le cinquième volet m’attend, j’abrège ce papier même si j’ai envie de consigner ici encore deux trois choses. J’étais parti pour griffonner quelques lignes et j’ai encore gratté trois pages. Certains défauts ne changeront jamais…
Je pars en vous laissant autre chose à lire, si vous avez le temps.
J’ai découvert Annie Ernaux au lycée où la prof de français nous avait donné à étudier La Place, un de ses romans qui m’avait profondément marqué, un bouquin sur la vie simple de son défunt père, écrit avec une précision chirurgicale, factuelle dans un style particulièrement dépouillé. J’ai également apprécié par la suite d’autres de ses romans, et si ce confinement s’éternise, il est probable que j’en profite pour en lire de nouveaux. Mais, je me disperse encore !
Pour l’émission de Trapenard sur France Inter, Annie Ernaux écrit une lettre ouverte à Macron, à la fois naïve, percutante, touchante et intelligente. C’est toujours rassurant de ne pas être déçu par des gens qu’on estime. Ce n’est pas toujours le cas.
J’espère que le président lira cette lettre. Et surtout qu’il la comprendra…
D’ici la prochaine fois, prenez soin de vous.


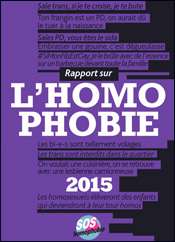

Oyez Oyez !